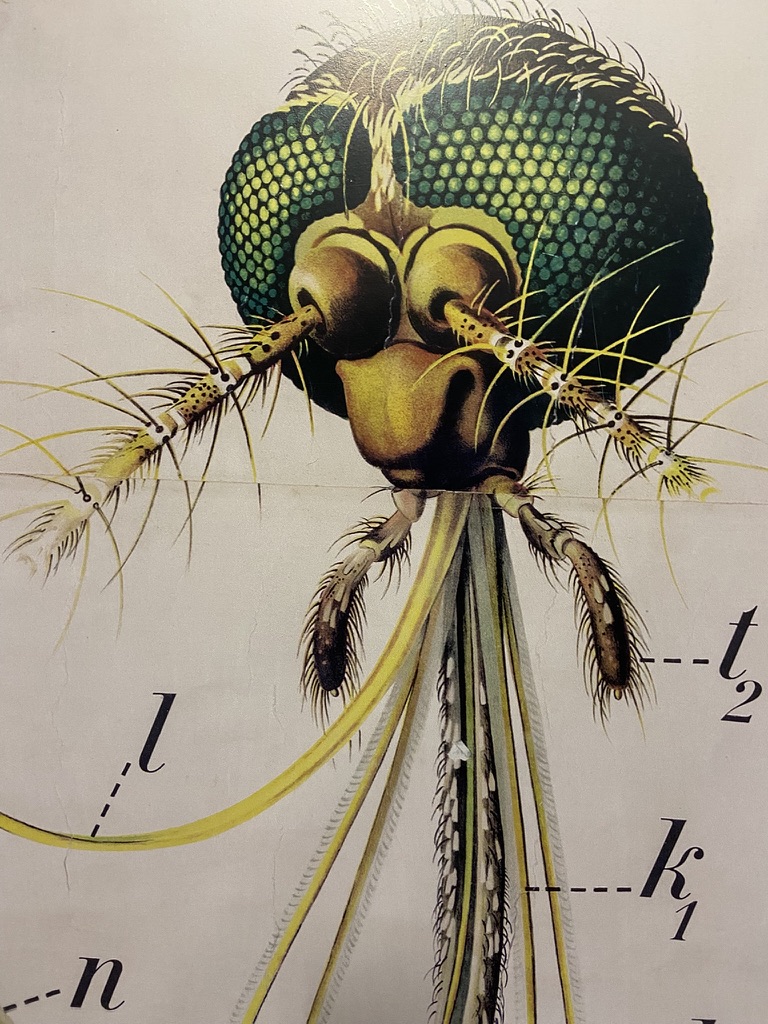La thématique des « Mondes sauvages » propose d’interroger les représentations, pratiques et imaginaires liés à ce qui est pensé comme extérieur à l’humain, au domestique ou au civilisé. Issu du latin silvaticus (« de la forêt »), le terme « sauvage » renvoie à ce qui échappe au contrôle humain et soulève de manière critique la manière dont l’art et la culture occidentale ont construit cette opposition.
Cette thématique invite à explorer les relations entre humains, milieux et autres vivants, mais aussi les technologies, en dépassant les dualismes hérités : nature/culture, sauvage/domestique, humain/non-humain. Il s’agit d’analyser comment les récits, images et dispositifs artistiques ont contribué à naturaliser certaines formes de domination (patriarcale, coloniale, anthropocentrée) et d’imaginer d’autres manières de représenter et de partager le monde.
Dans cette perspective, le travail artistique n’est pas seulement une production isolée, mais une enquête critique sur les conditions historiques, politiques et écologiques qui façonnent nos manières de voir et de créer. De la critique du Wilderness Act aux réflexions contemporaines sur la « nature férale », en passant par la pensée sauvage de Lévi-Strauss ou les analyses de Donna Haraway ou de Catherine Larrère, cette recherche ouvre un espace de confrontation entre savoirs et pratiques. Il s’agira de considérer ce qui, sur nos territoires urbains, dans les interstices et les corps disciplinés, relève du sauvage, considéré non comme une altérité menaçante mais comme un allié, une multitude d’espèces compagnes.
Cette thématique incite ainsi à reconsidérer le rôle de l’art : non pas célébrer une nature prétendument vierge ou conquise, mais proposer des formes qui révèlent l’entrelacement des histoires humaines et non-humaines, visibles et invisibles et inventer des récits alternatifs pour habiter un monde commun, par le compost, l’enchevêtrement, le devenir, les tresses et boucles.